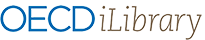L'immigration a des effets positifs, quoique limités, sur l’économie de la Côte d’Ivoire. Sur le marché du travail, les immigrés ne semblent pas peser négativement sur les salaires ou les conditions de travail de la population active autochtone. Les immigrés génèrent par ailleurs une valeur ajoutée supérieure à leur pourcentage dans la population et leur présence semble augmenter la productivité des entreprises informelles. Les estimations portant sur la contribution fiscale nette des immigrés varient pour leur part en fonction des hypothèses adoptées. Des politiques publiques visant à accroître les effets positifs de l’immigration supposent d'investir davantage dans l’intégration des immigrés et de relever le défi de l'informalité.
Comment les immigrés contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire est le fruit d’un projet mené conjointement par le Centre de développement de l’OCDE et l’Organisation internationale du travail (OIT), avec le soutien de l'Union européenne. Le projet vise à évaluer l’impact économique de l’immigration sous différentes dimensions – marché de l'emploi, croissance économique et finances publiques – dans les dix pays partenaires du projet : Afrique du Sud, Argentine, Costa Rica, Côte d' Ivoire, Ghana, Kirghizistan, Népal, République dominicaine, Rwanda et Thaïlande. Cet examen s’appuie sur une combinaison d’analyses quantitatives et qualitatives de données primaires et secondaires.
Afin de fonder empiriquement l’analyse des liens entre politique et migrations, le projet Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) en Côte d’Ivoire s’attache à recueillir des données au moyen de trois outils : des enquêtes auprès des ménages ; des enquêtes auprès des communautés ; et des entretiens avec des représentants d’organisations publiques, internationales et locales, permettant d’obtenir des informations qualitatives supplémentaires à propos des migrations en Côte d’Ivoire.Ce chapitre explique les outils utilisés, la méthode d’échantillonnage de l’enquête et décrit les approches statistiques utilisées dans les chapitres suivants pour analyser les effets de l’émigration, de la migration de retour, des transferts de fonds et de l’immigration sur les principaux secteurs ciblés par les politiques. Il comprend une synthèse des résultats d’enquête, y compris des différences entre les régions rurales et urbaines, et entre les ménages migrants et non-migrants. Il met en évidence des disparités hommes/femmes, en particulier en ce qui concerne le pays d’origine ou de destination et les raisons du départ, du retour ou de l’arrivée.
Les politiques sectorielles adoptées dans des domaines importants pour le développement, à l’instar du marché de l’emploi, de l’agriculture, de l’éducation, de l’investissement et des services financiers, ainsi que de la protection sociale et la santé, peuvent influer sur les décisions liées à la migration et sur le lien entre migrations et développement. Les enquêtes menées dans le cadre du projet Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) en Côte d’Ivoire intégraient un large éventail de programmes politiques menés dans ces cinq secteurs clés, dans l’objectif d’identifier quelques-uns des liens existant entre les politiques sectorielles et les migrations. Ce chapitre analyse en quoi les programmes conduits dans ces secteurs en Côte d’Ivoire influencent les décisions individuelles d’émigrer, de transférer des fonds ou de retourner au pays, ainsi que les perspectives d’intégration des immigrés.
La Côte d’Ivoire est un pays d’immigration depuis son indépendance de la France en 1960, voire avant, et ce, grâce à une politique d’ouverture relative à la main-d’œuvre étrangère. Une rétractation de son économie, une pénurie de terres et la possibilité d’une guerre civile entre 2002 et 2011 ont cependant ralenti l’immigration et accéléré l’émigration. Les immigrés représentaient 23 % de la population totale du pays en 1970, environ 15 % en 1990 et seulement 10 % en 2015. Malgré la paix en 2011 et le retour des flux d’immigration, l’émigration a continué et, avec elle, les perspectives des transferts de fonds vers le pays, ainsi que l’engagement et le retour de sa diaspora.
La Côte d’Ivoire ne tire pas suffisamment parti du potentiel de développement offert par les niveaux élevés d’immigration, mais aussi d’émigration, qui caractérisent le pays. Le projet Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) a été mis en œuvre en Côte d’Ivoire entre 2013 et 2017 afin d’étudier, au travers d’une analyse quantitative et qualitative, la relation bilatérale entre les migrations et les politiques publiques dans cinq secteurs clés : marché de l’emploi, agriculture, éducation, investissement et services financiers, et protection sociale et santé. Ce chapitre propose un aperçu des conclusions du projet, en mettant l’accent sur le potentiel de promotion du développement qu’offrent les migrations dans bon nombre de leurs dimensions (émigration, transferts de fonds, migration de retour et immigration) et en analysant les politiques sectorielles nationales qui en permettront la réalisation.
Les migrations, qu’il s’agisse de l’émigration ou de l’immigration, sont une caractéristique importante de la Côte d’Ivoire. Cependant, les liens entre leurs différentes dimensions et le développement ne sont pas très bien compris. Ce chapitre utilise des données d’enquêtes du projet Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) afin de démêler certains liens complexes entre, d’une part, l’émigration, les transferts de fonds, la migration de retour et l’immigration et, d’autre part, cinq secteurs essentiels en matière de développement : le marché de l’emploi, l’agriculture, l’éducation, l’investissement et les services financiers, ainsi que la protection sociale et la santé. L’analyse des grands flux d’immigration vers le pays et de la hausse récente de l’émigration permet de mieux comprendre la dynamique des migrations, ainsi que leurs liens avec l’économie et l’utilisation des services et des ressources publiques. Le chapitre conclut en évaluant le degré actuel de réalisation du potentiel de développement des migrations et des transferts de fonds en Côte d’Ivoire.
Les migrations ont toujours tenu une place importante dans l’histoire de la Côte d’Ivoire. Le pays accueille des immigrés depuis longtemps (en particulier en provenance du Burkina Faso), dans le sillage de sa politique migratoire relativement ouverte depuis les années 60. Plus récemment, la Côte d’Ivoire est également devenue un pays d’origine d’émigration. Cependant, faute de données suffisantes, il demeure impossible d’apporter des réponses politiques éclairées et cohérentes sur la question des migrations dans le pays. Le projet Interactions entre politiques publiques, migrations et développement en Côte d’Ivoire (IPPMD) – géré par le Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et cofinancé par l’Union européenne – a vocation à appuyer la prise de décisions en Côte d’Ivoire. Il s’efforce plus particulièrement de déterminer :
La Côte d’Ivoire est essentiellement un pays d’immigration, bien que l’émigration soit à la hausse. La politique d’immigration relativement ouverte lancée dans les années 60 a favorisé l’installation de nombreux immigrés dans le pays. Le conflit qui s’est déroulé de 2002 à 2011 a temporairement interrompu ces flux et augmenté l’émigration. Les transferts de fonds vers le pays ont également commencé à augmenter. Ce chapitre présente un aperçu des migrations en Côte d’Ivoire : leurs moteurs et leurs incidences, qui sont les migrants, et où ils sont allés, et ce que nous dit la documentation disponible sur les répercussions des migrations pour ceux qui restent au pays. Il se conclut par une présentation de la politique et du cadre institutionnel qui régissent les migrations en Côte d’Ivoire.
Interactions entre politiques publiques, migrations et développement en Côte d'Ivoire est le fruit d'un projet mené conjointement par l'Union européenne et le Centre de développement de l'OCDE, en collaboration avec l'Office national de la population (ONP) et le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CIRES). Ce projet avait pour objectif de fournir aux décideurs des données probantes sur l'impact des migrations sur des secteurs spécifiques – marché du travail, agriculture, éducation, investissement et services financiers, et protection sociale et santé – et, à l'inverse, de montrer quel est l'impact des politiques sectorielles sur les migrations. Le rapport aborde quatre dimensions du cycle migratoire : l'émigration, les transferts de fonds, le retour et l'immigration.
Les résultats des travaux empiriques confirment que les migrations contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Cependant, le potentiel des migrations n'est pas pleinement exploité dans le pays, notamment parce que les décideurs ne prennent pas suffisamment en compte les migrations dans leurs domaines d'action respectifs. La Côte d'Ivoire doit donc adopter un programme d'action plus cohérent pour mieux intégrer les migrations dans les stratégies de développement. Cela permettra d'accroître la contribution des migrations au développement du pays.
Ce chapitre aborde la question de la transformation structurelle et de la diversification de l’économie ivoirienne, indispensables pour atteindre l’émergence en 2020. La première section de ce chapitre présente un état des lieux de la structure économique actuelle. La deuxième section dresse la liste des opportunités pour mener à bien la transformation structurelle. Le choix des produits et secteurs proposés répond au double objectif de création d’emplois et de hausse de la valeur ajoutée, et se base sur les capacités existantes de l’économie ivoirienne. La dernière section présente les contraintes à lever et les conditions favorables à mettre en place pour permettre la réalisation des opportunités proposées. La faible concurrence dans l’économie, l’important secteur informel, la réduction du coût des intrants, la réforme foncière, le renforcement des capacités des acteurs, les progrès à réaliser en matière de facilitation du commerce, ou encore le rôle des technologies y sont abordés.
Le Volume 2 de l’Examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire, qui présente la phase II de l’étude, est le fruit d’une collaboration étroite entre le Centre de développement de l’OCDE et la Côte d’Ivoire. Une équipe multidisciplinaire de l’OCDE, composée d’experts de l’unité des Examens multidimensionnels par pays, du bureau Afrique et de l’unité Compétences du Centre de développement de l’OCDE, accompagnée d’un expert du Centre de politique et d’administration fiscales et d’un expert en infrastructure ont travaillé en partenariat avec la Primature de la Côte d’Ivoire pour la rédaction de ce rapport. Les experts ont été activement soutenus par une équipe de liaison ivoirienne qui a facilité l’organisation de la mission du 9-20 mars 2015 et a fourni l’accès à de nombreux documents nationaux et données figurant dans ce rapport.
Ce chapitre décrit l’état actuel du secteur financier ivoirien et formule des recommandations de politiques pour accélérer son développement. La première partie de ce chapitre montre l’importance d’un secteur financier performant et inclusif pour la réalisation de l’objectif d’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020. La deuxième partie présente les dysfonctionnements du système bancaire ivoirien qui pénalisent l’octroi de crédit aux entreprises et le développement des activités économiques. Les banques perçoivent le risque de crédit comme un obstacle important. La difficulté de constituer des garanties solides, l’absence de diversification des produits financiers, les capacités insuffisantes des acteurs, ou encore le faible respect des normes prudentielles par les établissements bancaires, constituent d’autres contraintes majeures. Enfin, la dernière partie insiste sur l’importance des alternatives au financement bancaire. En effet, la liquidité et le dynamisme du marché boursier régional sont limités, ce qui entrave le financement de certains secteurs d’activité.
Ce chapitre décrit le système fiscal ivoirien actuel ainsi que ses effets sur les entreprises et les individus. Il présente les données de recettes et de structures fiscales de la Côte d’Ivoire et les compare avec celles d’autres pays émergents, avant d’examiner plus spécifiquement la fiscalité indirecte (droits de douane, taxe sur la valeur ajoutée [TVA], droits d’accises), la fiscalité directe (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, impôt foncier), les incitations fiscales et le rôle de l’administration fiscale. Ce chapitre aborde également les liens entre la fiscalité et le secteur informel. Il propose enfin des recommandations concrètes pour la mise en place d’un système fiscal qui génère moins de distorsions et davantage de recettes pour financer les besoins croissants du pays en matière d’infrastructure, d’éducation et de santé. À terme, l’objectif est de faire de la politique fiscale un des leviers clefs de l’émergence.
La Côte d’Ivoire a pour objectif de devenir une économie émergente à l’horizon 2020. Le pays a été profondément affecté par une période de crise économique dans les années 80 et 90 et une crise politico-militaire dans les années 2000. Les autorités de Côte d’Ivoire affichent désormais la volonté de relancer durablement la croissance économique et de retrouver un statut de leader régional. Le Plan national de développement (PND) 2016-2020 fournit un cadre à leurs efforts, inscrit dans l’objectif de l’émergence en 2020.
À la sortie d’une décennie de crise, la Côte d’Ivoire souhaite renouer avec son succès économique passé et devenir un pays émergent à l’horizon 2020, objectif central de sa stratégie nationale de développement. Après l’indépendance, la Côte d’Ivoire était considérée comme l’un des pays leaders dans la sous-région et, plus largement, dans toute l’Afrique. En 1960, son produit intérieur brut (PIB) par habitant se situait à 900 USD (mesuré en dollars de 2005). À la fin des années 70, il avait presque doublé, atteignant 1 750 USD par habitant. Toutefois, une série de retournements économiques et de décisions politiques inadaptées ont précipité le pays dans une crise économique brutale dans les années 80 et 90. S’en est suivie une crise politico-militaire, qui a pris fin récemment. Depuis 2011, les efforts des autorités ont permis de relancer la sphère économique et la croissance s’élève désormais à environ 10 % par an. L’atteinte de l’émergence à l’horizon 2020 est désormais un objectif pour les autorités ivoiriennes. Ce chapitre présente une vue d’ensemble des transformations structurelles et économiques durables et inclusives qui permettront à l’économie ivoirienne d’avoir une structure plus adaptée à l’émergence.
Ce chapitre analyse les besoins en infrastructures économiques de la Côte d’Ivoire et propose des mesures pour améliorer la quantité et la qualité des infrastructures afin d’accompagner la marche vers l’émergence. La première partie de ce chapitre identifie les secteurs qui auront le plus grand impact sur la croissance économique et la productivité, et propose un cadre et des critères pour prioriser les grands projets structurants. La deuxième partie étudie les besoins en infrastructures des secteurs de l’électricité, des transports et des technologies de l’information et de la communication (TIC), et identifie les obstacles réglementaires ou structurels à l’efficacité et à la compétitivité de ces secteurs. Pour chacun de ces secteurs, elle propose également des projets prioritaires destinés à accélérer la croissance, augmenter la productivité et renforcer la compétitivité de l’économie ivoirienne. La dernière partie examine le schéma de gouvernance des infrastructures en Côte d’Ivoire, et identifie des mesures qui contribueraient à assurer le meilleur rapport qualité-prix et la soutenabilité financière des investissements en infrastructure.
Ce chapitre analyse le « système de compétences » ivoirien et la façon dont il s’articule avec le marché du travail pour répondre aux exigences de l’émergence. La première section est dédiée à l’examen de la capacité du système éducatif et de formation à développer les compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Cette section souligne les défis à relever en termes d’accès et de qualité à tous les niveaux d’éducation, d’amélioration des conditions d’enseignement, et de réduction des inégalités socio-économiques, de genre et spatiales. La deuxième section porte sur la mobilisation des compétences disponibles sur le marché du travail. Elle révèle une participation insuffisante des jeunes, des femmes et des diplômés au marché du travail ivoirien, ainsi que l’opportunité que constituent la diaspora et les migrants en termes de réservoir de compétences. La dernière section de ce chapitre traite de l’utilisation efficace des compétences en Côte d’Ivoire. Elle analyse l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences et la manière dont la segmentation du travail y contribue, et présente les compétences entrepreneuriales comme des opportunités de développement des secteurs clefs de l’économie.